You are currently browsing the tag archive for the ‘poétesses-écrivaines’ tag.
Ce beau poème m’a été donné en commentaire, et je le recopie ici pour que tout le monde en profite.
Pareil à moi, tu passes
Les yeux rivés au sol,
Je les baissais – aussi,
Passant, arrête-toi!
Boutons-d’or et pavots à la main,
Tu liras sur la pierre
Qu’on m’appelait Marina
Et l’âge que j’avais.
Non, ce n’est pas une tombe,
Je ne surgirai pas, menaçante.
J’ai trop aimé moi-même
Rire quand il ne faut pas.
Le sang frappait à mes tempes
Et mes boucles bouclaient;
Je fus aussi, passant!
Passant, arrête-toi!
Je n’accepte pas l’éternité
Pourquoi m’a-t-on ensevelie?
Je ne voulais pas quitter pour la terre –
Ma terre adorée.
Cueille une herbe sauvage
Et puis une fraise des bois –
Mûrie entre les tombes
Elle sera plus sucrée.
Mais ne te penche pas,
Triste, au-dessus de moi,
Évoque-moi sans peine,
Sans peine oublie-moi!
Comme le rayon t’éclaire
Il te poudroie d’or…
Que ma voix souterraine
Ne t’effarouche pas!
Koktebel, 3 mai 1913, in Le ciel brûle
Avant hier, c’était la Gay Pride : pour marquer le coup, un petit poème de Sappho…
 Envers vous, belles, ma pensée n’est point changeante.
Envers vous, belles, ma pensée n’est point changeante.
Je ne change point, ô vierges de Lesbos !
Lorsque je poursuis la Beauté fugitive,
Tel le Dieu chassant une vierge au peplos*
Très blanc sur la rive.
Je n’ai point trahi l’invariable amour.
Mon coeur identique et mon âme pareille
Savent retrouver, dans le baiser d’un jour,
Celui de la veille.
Et j’étreins Atthis* sur les seins de Dika.
J’appelle en pleurant, sur le seuil de sa porte,
L’ombre, que longtemps ma douleur invoque,
De Timas la morte.
Pour l’Aphrodita j’ai dédaigné l’Eros,
Et je n’ai de joie et d’angoisse qu’en elle :
Je ne change point, ô vierges de Lesbos,
Je suis éternelle.
***
Sappho, environ VIIe siècle avant JC
*péplos : tunique des femmes grecques
Atthis : jeune femme disciple de Sappho, dont la poétesse était amoureuse, mais qui dut quitter l’école pour être mariée. Il semble que le poème lui soit dédié.
Tableau : Klimt, Jeunes femmes
 Je vis, je meurs; je me brûle et me noie ;
Je vis, je meurs; je me brûle et me noie ;
J’ai chaud extrême en endurant froidure :
La vie m’est et trop molle et trop dure.
J’ai grands ennuis entremêlés de joie.
Tout à un coup je ris et je larmoie,
Et en plaisir maint lourd tourment j’endure ;
Mon bien s’en va, et à jamais il dure ;
Tout en un coup je sèche et je verdoie.
Ainsi Amour inconstamment me mène ;
Et, quand je pense avoir plus de douleur,
Sans y penser je me trouve hors de peine.
Puis, quand je crois ma joie être certaine,
Et être au haut de mon désiré heur,
Il me remet en mon premier malheur.
***
Louise Labé, Sonnets, 1555
Elle sera sur toi comme fond l’orage.
Comme une pierre rapace lancée des horizons.
Tu n’auras rien vu venir,
un battement de cil, à peine un soupir
et tu seras trempé.
Ivre d’eau, ivre d’elle, jusqu’au bout de l’âme.
***
Désirée Thomé, epinephrine.canalblog.com, 2010
Le vingt et un. La nuit. Lundi.
Les contours de la ville dans la brume.
Je ne sais quel nigaud a prétendu
Que l’amour existe sur la terre.
Paresse ? Ennui ? On y a cru.
On en vit ; on attend le rendez-vous.
On craint la séparation.
On chante des chansons d’amour.
D’autres découvrent le secret ;
Un silence descend sur eux…
Je suis tombée là-dessus par hasard.
Depuis, je suis comme malade.
***
Anna Akhmatova, Troupe blanche, 1917
Nos souvenirs connaissent trois périodes.
Dans la première, tout est comme hier,
l’âme se plaît sous leurs voûtes bénies,
le corps se plaît dans leur ombre propice
le rire vit encore, les larmes coulent,
la tache d’encre est encore sur la table –
et ce baiser comme un sceau sur le cœur,
unique inoubliable, baiser d’adieu…
Mais cette période n’est pas très longue.
Au lieu de voûtes bénies, une maison
solitaire dans un lointain faubourg,
où il fait froid l’hiver et chaud l’été,
où la poussière et l’araignée s’étalent,
où les lettres brûlantes en cendres tombent
et les portraits s’altèrent en cachette.
On y va comme on va sur les tombes,
en rentrant on se lave les mains,
en essuyant une larme fugace
des yeux lassés, avec un lourd soupir…
Mais l’horloge tictaque, les printemps
se suivent sans répit, le ciel rosit ;
le nom des villes eux-mêmes changent, et
s’en vont les témoins des événements.
Qui va pleurer, qui va se souvenir
et lentement nous abandonnent les ombres
que nous n’appelons plus, dont le retour
nous aurait même été effrayant.
Soudain éveillés, nous constatons que nous avons oublié jusqu’au chemin
de cette maison. Étouffant de honte,
nous y courons, mais (comme dans tous les rêves)
tout a changé : êtres, choses, murs –
Nous sommes étrangers. On nous ignore ;
Ailleurs, nous sommes ailleurs… seigneur Dieu !
Puis vient le plus terrible : nous voyons
que nous ne pourrions mettre ce passé
dans notre vie présente, et qu’il est
devenu aussi étranger pour nous
que pour notre voisin de palier ; que
nous ne saurions reconnaître nos morts
et que ceux dont le sort nous sépara
s’en accommodent parfaitement. Et même
que tout est pour le mieux…
***
Anna Akhmatova, « Quatrième élégie », in Elégies du Nord, Course du temps, 1945
Tableau : Van Gogh, « Pêchers en fleurs, souvenir de Mauves », 1888
Seigneur, est-ce donc vrai qu’en ces mois vous pêchez,
Sous les lunes de mai, les morts de la rizière,
Que leurs yeux sans regards et leurs cheveux noyés
servent la juste guerre?
Dans un calme jardin, nous voici donc assis,
et c’est le temps si beau de la fleur et de l’arbre.
On célèbre un tombeau d’où vous êtes parti.
Pâques fait son théâtre.
Faut-il tout pardonner pour un dieu qu’on nous donne?
Sur les cités d’Asie et sur l’enfant brûlé,
au Mont des Oliviers, en votre temps de l’homme,
n’avez-vous pas pleuré?
Sous l’eau j’ai vu glisser la fille aux jeunes seins
si longue dans sa mort! j’ai vu courir les mères
avec leur bouche ouverte qui ne criait plus rien.
Qu’en pense votre mère?
Le mot de paradis en cette nuit fait honte.
Des arbres à pendus dressent d’autres vergers.
Allons-nous oublier tout le malheur du monde
pour l’odeur d’un pommier?
A Charles Moureau
Femme venue à nous par la première femme
Avec cette douceur à lécher tes petits,
Riche comme la mort, plus creuse que la paille
Dans ce corps si profond agencé comme un nid,
Marché d’hommes, criée du soir, rapide fête,
Condamnée aux amours et de lait se mouillant,
Foire à plaisir soumise aux douze temps des bêtes,
Pourvoyeuse d’oubli, passage des vivants,
N’as-tu rien à prévoir, Porte des voluptés
Pour ce germe jeté qui te cherche et va prendre ?
Toi si douce à toucher par les longs soirs d’été,
N’as-tu pas la raison te pleurant dans le ventre ?
Ce que tu vas tenir plus tard dans l’air du monde,
Lié à toi, le temps qu’on te coupe de lui,
Sais-tu qu’il est gibier dès que tes flancs le donnent
Et que des morts vont naître aux hasards de ton lit ?
***
Tableau : Tamara de Lempicka, Andromède.
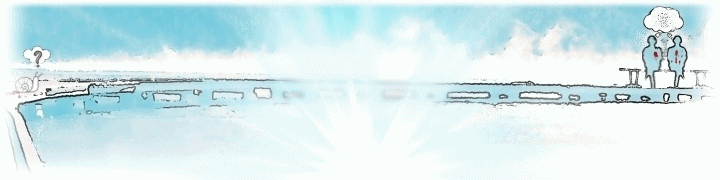





Commentaires récents